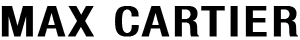« Max Cartier, l’homme aux mains d’or »
L’artiste a un physique de jeune premier, pas étonnant alors qu’il ait commencé sa vie professionnelle comme comédien et son premier film (devenue aujourd’hui mythique) était « Rocco et ses frères » de Luchino Visconti où il est le partenaire d’Alain DELON et d’Annie GIRARDOT. Il tourne ensuite dans de nombreux films (tous restés célèbres) : L’assassin de Marcello Mastroiani, le roi des truands avec Ernest Borgnine, Giuliano avec Franscesco Rosi…
Par la suite, Max CARTIER ouvre un restaurant a Nice ou l’on rencontre DELON, BRIALI, Paul Newman et toutes les stars des années 60 et puis il a l’occasion de découvrir la sculpture et c’est, pour lui, une révélation. A partir de 1965, il travaille et expose. Ses thèmes sont les plus divers : les cocottes en tissus en 65, les jambes en 70, les plâtres, les étains et miroirs en 75, les masques en 79, les œufs en 80, l’école des chaises en 84, les fauteuils en tissus en 86, les poêles en 87, les enlacés en 90, les hommes de pierre en 91, les hommes de fer en 92… Max CARTIER est en évolution constante.
Il faut le voir travailler dans une carrière, plein soleil, dans l’arrière pays niçois pour comprendre qu’il n’y a aucun bluff chez cet artiste. Il extrait les pierres, les façonne légèrement pour leur garder un coté brut et millénaire et les assemble en se moquant de leur poids, afin de les fier dans ses rets de fers torsadés.
Dans l’immense jardin près de NICE où est installé son atelier, ses créatures posées les unes à cote des autres font penser à de guerriers d’un autre âge. Max CARTIER a choisi d’exprimer ses émotions à l’aide de matériaux puissants, rugueux et éternels, provenant du plus profond de la terre afin de découvrir la lumière et se transformer en créatures monumentales représentant la force et l’éternité.
« Mes hommes de pierre et mes hommes de fer sont les guerriers de l’impossible ; même s’ils sont apparemment élémentaires, ils détiennent en eux les clefs du devenir. »
C.B.
DES STUCS DE CINECITTA SELON LUCHINO VISCONTI AUX ROCHERS BRUTS DES « HOMME DE PIERRES », L’ETONNANT DESTIN DE MAX CARTIER, ARTISTE « MULTICARTES »
Le sculpteur niçois Max Cartier n’est pas « nouveau réaliste ». Encore qu’il ait compté nombre d’amis dans le mouvement, dont le père fondateur et théoricien, le critique d’art Pierre Restany, s’est intéressé à son travail. Max Cartier n’appartient pas à « L’Ecole de Nice », quoi qu’il lui soit arrivé d’exposer avec le groupe, notamment à son origine, à la galerie Alexandre de La Salle. Et quoi qu’à la différence de beaucoup d’artistes réunis sous cette appellation fort peu contrôlée, lui ait vraiment fait, au moins partiellement, ses classes à Nice la ville aux bords de la Baie des Anges ayant contribué, à la fois, à sa formation et à nourrir son imaginaire avant de stimuler son inspiration. Difficile de rester sourd aux appels de la création, lorsqu’on habite le coeur d’une région où se sont exprimés tour à tour ou simultanément Renoir, Matisse, Picasso, Chagall, Braque, Léger, Bonnard, et beaucoup d’autres, sans remonter à Carle VanLoo et aux Bréa…
Quoi qu’il en soit, et compte tenu de cette histoire, il paraît donc assez normal que Max Cartier ait fini par être distingué au Musée d’Art Moderne et d’Art contemporain de Nice où l’un de ses colosses de pierre vient d’être installé, sentinelle minérale montant la garde sur le parvis, face à la « bibliothèque Louis Nucéra » établie depuis peu dans la « Tête au Carré » de Sosno qu’elle semble narguer. Une position idéale pour veiller sur les collections du M.A.M.A.C., où figurait déjà une oeuvre de Max Cartier: un « en-lacets », représentatif des années 80…
Par ailleurs, Max Cartier ne relève pas davantage de « Fluxus », de la
« Nouvelle Réalité », de « Support-surface » (toutes tendances illustrées par des artistes ayant Nice, plus ou moins, comme dénominateur commun) : il est, au demeurant, irréductible à quelque « famille » artistique que ce soit.
Max Cartier est Max Cartier, tout simplement. Il est atypique, hors normes. Etranger aux circuits habituels de la création artistique. Il n’a pas « fait les Beaux-Arts » ni même la vénérable école des arts-décos de la rue de l’Escarène, ou l’école municipale de dessin de la Villa Thiole. Mais il était Max Cartier à l’identique, égal à lui-même, longtemps avant de songer à faire le plasticien. Et il avait acquis une forme appréciable de célébrité dés 1960, en tant que… vedette de cinéma. Pas une vedette « pour de rire » : il avait été l’interprète de Luchino Visconti dans l’un de ses meilleurs films, « Rocco et ses frères », plébiscité à la « mostra » de Venise avant de venir figurer en bonne place parmi les chefs d’œuvres incontestés de l’histoire du cinéma. Max – qui n’avait pas 21 ans -y imposait son humanité et sa belle gueule dans le rôle de Ciro, le frère de Rocco-Alain Delon dont la vieille camaraderie d’enfance l’avait entraîné dans l’aventure du cinéma. Avec eux dans une distribution de rêve, Renato Salvatori, Paolo Stoppa, Annie Girardot, Claudia Cardinale, Roger Hanin, Suzy Delair, Katina Paxinou…
C’est à une sorte de clin d’oeil du destin que Max Cartier doit d’être arrivé là où rien ne le prédisposait. Pas sa naissance à Draguignan, d’un couple précaire qui ne résistera pas à son arrivée. La mère ayant repris sa route sans lui, le père ne pouvant l’assumer seul, il est un moment laissé à la garde d’une famille calabraise de Fréjus, avant de retrouver son père qui le confie à sa grand-mère. Elle habite Grasse, et Max vivra auprès d’elle ce qu’il estime aujourd’hui avoir été « les années les plus heureuses de sa jeunesse ». Pas les plus faciles: ils sont pauvres, et pour survivre, il ne faut pas chômer : levé chaque matin, en saison, dès avant l’aube, le garçonnet suit sa grand-mère dans les champs où l’on ramasse le jasmin, la rose de mai ou la violette. Beaucoup d’efforts pour peu de profit. Afin de trouver mieux, Max adolescent « émigre » à Nice. Il y sera d’abord apprenti boulanger/pâtissier : ce qui lui vaut déjà le privilège de dormir au chaud: au-dessus du fournil. Et, comme l’apprentissage se déroule à l’orée du cours Saleya, il peut, en outre, arrondir ses fins de mois en allant donner le coup de main aux marchandes des quatre- saisons qui animent le plus niçois des marchés. Ses moments de liberté, aux beaux jours, il les passe régulièrement sur la plage d’Eze-sur-Mer, où deux commerçantes amies de sa grand-mère disposent d’un cabanon. Entre deux plongeons, il se lie d’amitié avec un garçon de son âge, aussi « beau ténébreux » et solitaire que lui. Au cinéma, quelques années plus tard, il deviendra célébrissime sous le nom d’Alain Delon…
 Leurs copains de cette époque travaillent presque tous dans le bâtiment. Ils en sont fiers, et du coup, Max, qui les envie, va changer d’orientation. Abandonnant le pétrin et les p’tits gâteaux, il apprend la plomberie, ce qui implique la zinguerie et le chauffage central. Le boulot paie (et lui plait) bien : rapidement l’élève passe maître dans l’art de souder, polir, braser le cuivre, découper, façonner les métaux et même -car le bon artisan doit savoir tout faire- restaurer une maçonnerie dégradée. A l’usage, ce garçon qui n’a pas fait d’études approfondies se révèle une espèce de génie manuel. Sous ses doigts formés à pétrir, malaxer, ajuster, modeler, puis à assembler de toutes les manières, depuis, la colle jusqu’à l’ensemble des techniques de soudure, les matériaux les plus divers se font dociles. Très vite et pour son seul plaisir d’abord, l’ouvrier émérite se met à inventer et à fabriquer des objets à partir de produits de récupération. S’étant avisé, par exemple, de la beauté des ferrailles et céramiques (ou verres) servant d’isolateurs pour les lignes à haute tension, il en réunit un grand nombre dans un fauteuil monumental sont la ligne, l’originalité (et paradoxalement, le confort) séduisent l’architecte Jacques Couelle. concepteur ( entre autres) du « village des milliardaires » de Castellaras, qui s’en porte aussitôt acquéreur, et demande à l’auteur d’imaginer avec lui d’autres éléments du décor avant même que Max Cartier ait imaginé de vendre sa création. Stimulé par ce succès initial, tout autre que Cartier eût sans doute envisagé d’exploiter le filon, en produisant, dans le même esprit, des lignes de mobilier décoratif. Mais Max est trop naturellement artiste, pour avoir le réflexe marchand. D’ailleurs il a déjà lancé (il n’a pas vingt ans) son entreprise de plomberie et elle se porte bien. Assez vite, il lui faut embaucher : un, deux, quatre, jusqu’à une dizaine d’employés. Parfois, le marché de l’immobilier stagne un peu, sur la Côte d’Azur, mais il lui faut continuer d’assumer cette main d’œuvre de copains. Alain Delon, avec qui il reste en relation et qui ne l’oublie pas, malgré son ascension cinématographique, lui propose un jour de venir tenter sa chance à Paris où, selon lui, le marché reste porteur. Le jeune entrepreneur n’aura pas trop le loisir de s’en assurer. A son arrivée, il trouve Alain Delon fort occupé à faire des photos à la demande de son agent. Spontanément, il associe son ami à ces « photo-calls » dont Max ignore la destination: c’est la « Titanus films », la société italienne de production, qui cherche à recruter pour le nouveau film de son réalisateur- phare, Luchino Visconti. En principe, le rôle de « Ciro » (le jeune frère de Rocco/Delon) est déjà attribué: à Gérard Blain, alors acteur fétiche de la « Nouvelle vague ». Mais au vu des photos, Visconti change d’avis: dans ce caractère, dur et bien trempé, de jeune italien du Mezzogiorno venu tenter de faire son trou dans la nord industriel, le plombier provincial sans références filmographiques lui semble d’emblée plus crédible que le brillant jeune premier parisien. La suite rendra justice à sa clairvoyance: « Rocco et ses frères » fait un tabac à la « mostra » de Venise, et Max Cartier sera régulièrement cité comme l’un des trois meilleurs protagonistes du film. Ce qui, vu la qualité d’ensemble de la distribution, n’est pas un mince compliment. Aussi, nul n’en doute dans les milieux du Septième art : lancée sous de pareils auspices, la carrière du jeune niçois semble promise à un brillant avenir. Et de fait, les propositions abondent: de Visconti d’abord pour un « Carmen » en Espagne qui ne se fera pas. De Francesco Rosi pour un « Salvatore Giuliano » que la censure transalpine arrête en plein tournage. Pas d’opposition, en revanche, à la réalisation de « L’Assassin » qu’un autre « grand » d’Italie, Elio Petri, va tourner en 1961 : ce qui vaut à Max Cartier d’être le partenaire de Marcello Mastroianni et de Micheline Presle. On va le voir encore dans « Le roi des truands »: une fantaisie napolitaine avec Ernest Borgnine. On l’aperçoit dans « Les grands moments », tourné par Claude Lelouch près du Logis-du-Pin. Et puis d’un coup, plus rien, ou presque; du moins, sur les écrans. Abandonnant Cinécitta, Max Cartier revient à Nice, mais pas à la plomberie. S’étant trouvé un local dans ses moyens, avenue Cyrille Besset (un quartier de Nice populaire et bon enfant où personne avant lui n’avait imaginé ouvrir un lieu à la mode), il s’établit restaurateur en 1962, à l’enseigne de « La Camargue » (première du nom). Il explique, aujourd’hui :
Leurs copains de cette époque travaillent presque tous dans le bâtiment. Ils en sont fiers, et du coup, Max, qui les envie, va changer d’orientation. Abandonnant le pétrin et les p’tits gâteaux, il apprend la plomberie, ce qui implique la zinguerie et le chauffage central. Le boulot paie (et lui plait) bien : rapidement l’élève passe maître dans l’art de souder, polir, braser le cuivre, découper, façonner les métaux et même -car le bon artisan doit savoir tout faire- restaurer une maçonnerie dégradée. A l’usage, ce garçon qui n’a pas fait d’études approfondies se révèle une espèce de génie manuel. Sous ses doigts formés à pétrir, malaxer, ajuster, modeler, puis à assembler de toutes les manières, depuis, la colle jusqu’à l’ensemble des techniques de soudure, les matériaux les plus divers se font dociles. Très vite et pour son seul plaisir d’abord, l’ouvrier émérite se met à inventer et à fabriquer des objets à partir de produits de récupération. S’étant avisé, par exemple, de la beauté des ferrailles et céramiques (ou verres) servant d’isolateurs pour les lignes à haute tension, il en réunit un grand nombre dans un fauteuil monumental sont la ligne, l’originalité (et paradoxalement, le confort) séduisent l’architecte Jacques Couelle. concepteur ( entre autres) du « village des milliardaires » de Castellaras, qui s’en porte aussitôt acquéreur, et demande à l’auteur d’imaginer avec lui d’autres éléments du décor avant même que Max Cartier ait imaginé de vendre sa création. Stimulé par ce succès initial, tout autre que Cartier eût sans doute envisagé d’exploiter le filon, en produisant, dans le même esprit, des lignes de mobilier décoratif. Mais Max est trop naturellement artiste, pour avoir le réflexe marchand. D’ailleurs il a déjà lancé (il n’a pas vingt ans) son entreprise de plomberie et elle se porte bien. Assez vite, il lui faut embaucher : un, deux, quatre, jusqu’à une dizaine d’employés. Parfois, le marché de l’immobilier stagne un peu, sur la Côte d’Azur, mais il lui faut continuer d’assumer cette main d’œuvre de copains. Alain Delon, avec qui il reste en relation et qui ne l’oublie pas, malgré son ascension cinématographique, lui propose un jour de venir tenter sa chance à Paris où, selon lui, le marché reste porteur. Le jeune entrepreneur n’aura pas trop le loisir de s’en assurer. A son arrivée, il trouve Alain Delon fort occupé à faire des photos à la demande de son agent. Spontanément, il associe son ami à ces « photo-calls » dont Max ignore la destination: c’est la « Titanus films », la société italienne de production, qui cherche à recruter pour le nouveau film de son réalisateur- phare, Luchino Visconti. En principe, le rôle de « Ciro » (le jeune frère de Rocco/Delon) est déjà attribué: à Gérard Blain, alors acteur fétiche de la « Nouvelle vague ». Mais au vu des photos, Visconti change d’avis: dans ce caractère, dur et bien trempé, de jeune italien du Mezzogiorno venu tenter de faire son trou dans la nord industriel, le plombier provincial sans références filmographiques lui semble d’emblée plus crédible que le brillant jeune premier parisien. La suite rendra justice à sa clairvoyance: « Rocco et ses frères » fait un tabac à la « mostra » de Venise, et Max Cartier sera régulièrement cité comme l’un des trois meilleurs protagonistes du film. Ce qui, vu la qualité d’ensemble de la distribution, n’est pas un mince compliment. Aussi, nul n’en doute dans les milieux du Septième art : lancée sous de pareils auspices, la carrière du jeune niçois semble promise à un brillant avenir. Et de fait, les propositions abondent: de Visconti d’abord pour un « Carmen » en Espagne qui ne se fera pas. De Francesco Rosi pour un « Salvatore Giuliano » que la censure transalpine arrête en plein tournage. Pas d’opposition, en revanche, à la réalisation de « L’Assassin » qu’un autre « grand » d’Italie, Elio Petri, va tourner en 1961 : ce qui vaut à Max Cartier d’être le partenaire de Marcello Mastroianni et de Micheline Presle. On va le voir encore dans « Le roi des truands »: une fantaisie napolitaine avec Ernest Borgnine. On l’aperçoit dans « Les grands moments », tourné par Claude Lelouch près du Logis-du-Pin. Et puis d’un coup, plus rien, ou presque; du moins, sur les écrans. Abandonnant Cinécitta, Max Cartier revient à Nice, mais pas à la plomberie. S’étant trouvé un local dans ses moyens, avenue Cyrille Besset (un quartier de Nice populaire et bon enfant où personne avant lui n’avait imaginé ouvrir un lieu à la mode), il s’établit restaurateur en 1962, à l’enseigne de « La Camargue » (première du nom). Il explique, aujourd’hui :
-« En Italie, c’était l’impasse: j’avais des propositions, certes, d’autant que c’était la grande époque des co-productions franco-italiennes.
Seulement voilà: les professionnels transalpins avaient constaté que dans ces distributions franco-italiennes, ils devenaient de plus en plus minoritaires.
Aussi, à l’appel de leurs syndicats, ils ont déclenché une grève très dure, qui allait durer cinq mois. D’un coup, on ne tourna plus rien. Moi, je n’avais pas la possibilité de me croiser les bras et d’attendre. Grâce à Visconti et au succès de « Rocco », j’avais la cote en Italie. Dans les autres cinématographies, je n’avais encore rien fait pour qu’on songe à faire appel au débutant que j’étais… »
En attendant, il faut vivre, et faire vivre sa jeune femme, bientôt mère de leur enfant. Alors, oubliant son statut tout frais de « vedette de cinéma », Max Cartier fait ce qu’il sait faire: il retrousse ses manches, et d’un local brut de décoffrage, il va tirer sa « Camargue ». Ex nihilo: il fait tout, du sol au plafond en passant par les murs, comme il l’a vu faire au cinéma, tant de fois. Il crée un ensemble harmonieux, à l’exemple de ceux dont il a eu la révélation chez Visconti, dans sa propriété où il a habité les deux dernières années.
Car Luchino n’est pas seulement l’un des cinéastes les plus doués de sa génération. Il est d’abord le comte Luchino Visconti di Modrone: un grand aristocrate, héritier d’une des plus illustres familles de Lombardie. Un esthète : s’il a pu mettre autant de vie dans son art, c’est qu’il y a toujours eu -depuis des générations -énormément d’art dans sa vie, une vie dont il a d’instinct su faire une œuvre d’art, sous l’influence, probable, des chefs d’œuvres dont il a toujours été entouré. Comme il est entouré de quelques uns des plus grands artistes de son temps, séduits par son hospitalité élégante et patricienne: il n’a pas de rival lorsqu’il s’agit de dresser le décor ou de mettre, avec classe, « les petits plats dans les grands ».
A partager, comme protégé de Visconti, le quotidien de ces nombreux familiers de la beauté sous toutes ses formes (et de l’originalité dans sa recherche), Max Cartier, curieux de tout, mais indifférent aux apparences, parachève sa formation. En somme, ce manuel autodidacte a toujours eu d’excellentes fréquentations et- esprit ouvert -il a su s’en imprégner. Ainsi par exemple, et entre beaucoup d’autres, de Maria Callas. Diva parmi les divas, elle séjournait fréquemment chez son ami Luchino, mais cette écorchée vive, qui ne supportait pas de rester seule, fût-ce dans un palais, s’installait à l’hôtel sitôt que Visconti devait s’absenter. C’est ainsi qu’un jour, sur la prière du metteur en scène, Max Cartier se retrouva pendant plusieurs mois, « homme de compagnie », « escorte » personnelle de « la Callas », entre le palace où elle s’était réfugiée dés le départ de Visconti, et la « Scala », où elle répétait. Une proximité avec une très grande artiste, généreuse et cultivée, dont il faudrait être étrangement obtus, pour ne pas retirer de précieuses leçons. Non des leçons de chant ou d’art lyrique, mais un enrichissement exceptionnel dans l’art d’appréhender la beauté et dans la modernité.
Toutes notions que Max Cartier s’empressera de mettre en pratique dans l’aménagement de « la Camargue ». Il n’a pas les moyens d’aligner, comme chez Visconti, les œuvres d’art, les antiquités glorieuses, les meubles rares et les toiles de maîtres, entre des murs tendus de tapisseries ou de lambris précieux. Alors, il improvise, sur le tas. Le chantier de son restaurant devient le premier « atelier » de celui qui n’avait jamais eu les moyens de s’en offrir un. Histoire de faire riche, de meubler en éclairant l’espace, il imagine, par exemple, le revêtement mural en « casse » de miroirs. Peut-être a-t-il été inspiré, là, mais alors de très loin et à son insu car il n’a jamais été un théoricien, par certains emplois de fragments de faïences murales assemblés par Gaudi dans la « Sagrada Familia », sa flamboyante église de Barcelone.
Quoi qu’il en soit, Cartier n’imite rien: il innove, n’utilisant que d’aléatoires bris de glace, qu’il sertit dans le plomb ou l’étain, afin d’éliminer les bords coupant. Extrapolant d’après la même technique, il fait naître d’extraordinaires « cocottes », sous le regard intéressé de César qui saura s’en souvenir longtemps après (nous sommes au début des années 60). Mais Max Cartier admire trop sincèrement le grand artiste au parcours, comme le sien, atypique, pour le soupçonner de plagiat. « Avec son oeil extraordinaire, je pense qu’il a perçu, d’emblée, les partis artistiques qu’il y avait à tirer de mes « bricolages ». S’il a pu utiliser, plus tard et ponctuellement, un tant soit peu de ce qu’il m’avait vu faire, à « la Camargue »ou dans un autre de mes établissements, ce m’est un grand honneur. S’il m’arrivait de remarquer, devant lui, « mais, là, tu utilises mon travail! », il se contentait de sourire : peut-être, me disait-il, mais toi, tu n’en fais pas profession. Ce serait dommage de laisser perdre ça, sans essayer d’en tirer quelque chose. Alors, probable que ses fameuses « poulettes » ont volé plus loin que mes « cocotes »: je ne lui en veux pas, et je ne suis pas peu fier que les miennes aient précédé les siennes.
Il est à noter que le simple constat adressé à celui qui était alors, de fait, plombier-acteur-restaurateur : « toi, tu n’en fais pas profession… (de tes talents d’artiste -n.d.l.r.), continue étrangement de coller aux basques de Max Cartier, longtemps après qu’il soit devenu plasticien à part entière. Tout se passe un peu comme si les artistes « conceptuels » -ceux qui « font faire » (à Piétrasanta ou ailleurs), les œuvres qu’ils n’ont pas l’envie, le temps ou les moyens techniques, de réaliser de leurs propres mains, lui reprochaient, au fond, d’être resté fidèle à la mystique du bon ouvrier, pour qui le tour de main vaut toutes les meilleures formations académiques. Si les « Hommes de Pierres » sont un concept, alors seul un Max Cartier possédait le pouvoir de le matérialiser pour en faire -concrètement -une « œuvre ».
Lorsqu’on le voit aujourd’hui (à plus de 60 ans), se colleter avec des rochers souvent de plusieurs tonnes, qu’il va trier, manipuler tout seul à l’aide d’un petit chariot élévateur, afin de constituer peu à peu chaque partie du corps d’un de ses « Hommes » cyclopéens, lorsqu’on le voit solidariser ces blocs avec des « tendons » en barres de fer à béton tordues’, retordues, nouées à la flamme d’un chalumeau, avec des « clefs » de ferrailleur, le tout sous le soleil écrasant de sa campagne-atelier de Levens, on s’étonne qu’il n’y ait pas au moins un manœuvre pour l’aider, voire quelques « assistants » pour effectuer, sous ses directives, le plus gros du travail: -« je me sens incapable de « déléguer » de cette façon, dit-il. Pour ce travail, j’ai besoin d’improviser ; d’essayer mes pierres, d’en changer en fonction d’un but à atteindre que je suis seul à connaître. Et encore: quelquefois, ma sculpture ne me devient »lisible » qu’une fois terminée. Sans doute y a-t-il dans ce processus un certain nombre d’étapes dont je pourrais -matériellement -m’affranchir, en les faisant exécuter par des aides: mais alors, ce ne serait plus « mon » travail. Ce ne serait pas 1 ‘homme de pierre que j’aurais imaginé. Lorsque j’en fais un, j’ai besoin de savoir d’où viennent les blocs: de quelle carrière, ou de quelle fouille; j’ai besoin de choisir chaque pierre selon ses dimensions et sa forme naturelles car je m’interdis de les retailler, de les retoucher ; il me semble qu’elles doivent figurer dans l’œuvre, telles que la nature me les a transmises, telles qu’elle les a façonnées aux fins fonds de la nuit des temps. En somme, je crois que je vois dans chacun de mes « hommes de pierres » comme un voyageur du temps, porteur de quelque mystérieux message. Du temps, et aussi de l’espace: les pierres dont il est fait ont un aspect qui correspond au terroir d’où elles ont été extraites. Mes « hommes » seraient forcément autres, si je travaillais ailleurs, avec les pierres d’autres formations géologiques. C’est d’ailleurs un de mes projets: je rêve d’aller travailler en Bretagne, avec le granit de là-bas, en Auvergne avec des roches volcaniques, dans le Var, avec la bauxite des Maures ou le porphyre de l’Estérel, etc. Cela me tente, de constituer peu à peu une « armée de pierre » où chaque « soldat » serait constitué de la matière de son lieu d’origine. On pourrait imaginer, de la sorte, des hommes de pierres aux couleurs des races présentes sur notre terre: « minéraliser » ainsi les ethnies, ce serait un moyen de les rendre, symboliquement et définitivement, fraternelles, en rappelant qu’elles sont toutes le produit de la même terre et de la même durée… ».
Mais revenons à « La Camargue ». Lorsqu’il inaugure la première, en juillet 1962, les gens du quartier Cyrille Besset, les journalistes venus en nombre n’en croient pas leurs yeux. Ils s’attendaient à un pot entre amis, une sorte de fête de quartier: quelle n’est pas leur surprise de voir débarquer pêle-mêle, comme pour un gala au festival de Cannes, Annie Girardotet Renato Salvatori, Romy Schneider et encore Jean-Claude Brialy, Régine, Mme Geneviève Fath, Franco Rossellini, Angelo Ponce de Léon, Jean Laffont… Les uns vident leurs verres, d’autres les remplissent ou les lavent. Romy sert au bar, et Régine, aidée de J-C. Brialy, tient le vestiaire…
Aussi brillamment lancée, « la Camargue » tient davantage encore que ses promesses: elle ne désemplit pas. Max et sa jeune femme ne savent bientôt plus où placer leurs hôtes. Pas question pour lui de s’éloigner du comptoir, le temps d’aller faire quelques « pannes » à Cinécittà. Il y a des compensations: des clients inattendus qui deviennent des amis. Jean Cocteau par exemple, venu en voisin, de Villefranche-sur-Mer. Lorsque, des années plus loin, Max ouvrira un autre club -« Le Bateau Ivre » sur le nouveau port de Beaulieu, le poète et plasticien saura se souvenir de ces soirées d’amitié à la première « Camargue » : quelques uns de ses amples dessins viendront illustrer les murs du « Bateau Ivre », parmi de nouvelles créations de Max.
Lancé sur la spirale du succès, la « Camargue » n° 1 devient rapidement trop étroite; d’autant qu’ Alain Delon, séduit par le concept et par son impact sur les clients, suggère une association, entraînant à sa suite, comme de juste, son éternelle fiancée, Romy Schneider -au faite de sa gloire et de sa beauté. C’est une opportunité inespérée, une de ces propositions qu’on ne refuse pas. Encore faut-il pouvoir suivre, et en l’occurrence, voir plus grand. Max qui connaît bien le quartier de son adolescence, trouve ce qu ‘il leur faut à l’orée du cours Saleya Ce sera la grande « Camargue », rendez-vous obligé du tout Côte d’Azur nocturne pendant deux bonnes décennies. En attendant qu’elle soit en mesure d’ouvrir ( et de produire des recettes) dans un décor, là encore, créé de toutes pièces, avec un souci raffiné du détail, Max réaménage l’ancien restaurant et y crée « Le Four », avenue Cyrille Besset, lequel fait vite recette avec les habitués de son prédécesseur.
 Mais à l’ouverture de la nouvelle « Camargue », une révision déchirante s’impose: Max ne peut être partout, et comme il est désormais établi par l’expérience que le succès repose sur sa présence, sa personnalité et ses réseaux, le choix est fixé d’avance.. « Le Four » en plein essor devra fermer ses portes.
Mais à l’ouverture de la nouvelle « Camargue », une révision déchirante s’impose: Max ne peut être partout, et comme il est désormais établi par l’expérience que le succès repose sur sa présence, sa personnalité et ses réseaux, le choix est fixé d’avance.. « Le Four » en plein essor devra fermer ses portes.
Mais comme on ne change pas une équipe qui gagne, Max transfère son restaurant quai des Etats-Unis, à deux pas de la « Camargue », où il a pu racheter après sa fermeture « Le Cabanon du Pêcheur », aussitôt remplacé, donc, par « Le Four ». Le pari audacieux se révèle à nouveau judicieux, une symbiose se mettant en place entre « Le Four » et « La Camargue ». Si bien que 1 ‘heureux propriétaire y ajoute bientôt un glacier conçu suivant les mêmes principes de convivialité, et imagine une nouvelle formule, histoire de faire encore mieux fructifier son ticket gagnant. Une formule digne de sa nouvelle réputation de « roi de la nuit », digne de l’emplacement et de ses prestigieux associés. De l’appartement situé au dessus du « Cabanon du Pêcheur », il va faire le « Rolls Club » : Une sorte d’éblouissante « salle d’attente » avant d’accéder à « La Camargue », vite surbookée. C’est un salon hyper glamour où bientôt, les « happy fews » de la Côte d’Azur se presseront pour être vus. La carte de membre du « Rolls club » (un rectangle de plastique dans lequel la photographie du détenteur a été découpée à l’emporte-pièce, comme pour une « oblitération ») s’arrache.
« La Camargue » 1 et 2, « Le Four », « Le Cabanon du Pêcheur », un glacier, le « Rolls Club » : multipliant les affaires avec bonheur, l’artiste tournerait-il « homme d’affaires » ? Pas vraiment, car tous les nouveaux lieux deviennent autant d’ateliers où il y a tout à faire. Alors Max Cartier, qui n’a jamais appris à faire travailler les autres ou l’argent des autres, fait tout. Poussé par « le hasard et la nécessité », le créateur se multiplie, organisant le décor, la carte, l’accueil, et produisant en fonction des besoins les objets et les ensembles qui rendront les lieux inoubliables…
Lorsque l’art décoratif et la restauration « pas rapide » cessent de le mobiliser complètement,il revient à la création pure: commandée uniquement par son inspiration et son bon plaisir; assuré de ses revenus par son travail, il n’a aucune concession à faire au « goût du jour ».Il ne dépend, ni des commandes, ni de la médiatisation (il aurait pourtant tous les arguments pour provoquer les prurits « jet-setters » des magazines « people » ), ni des lubies des « galeristes ». Il continue à n’être d’aucune école, d’aucune côterie.1l a quelques amis artistes de tous les horizons; quelques détracteurs systématiques, que son indépendance paraît agacer, et avec tout ça, il continue d’aller son bonhomme de chemin, plus soucieux de la cohérence interne de sa démarche créatrice que des remous en eaux troubles qui n’en finissent pas d’agiter les marigots de l’art (dans lesquels on est toujours le « crocodile en trop » de quelqu’un). En 1984 par exemple il travaille sur le thème des chaises. Il aurait pu imaginer de les accumuler, à la manière d’Arman ; de les « compresser » comme César ou de les « oblitérer » à la Sosno, sans pour autant copier l’un ou l’autre de ces plasticiens; il ne fait rien de cela. Il les transforme à sa manière. Ces chaises métalliques de jardin public, tout~s identiques, il commence par se les approprier. Il les colore, les brûle, les soude diversement, les amalgame, créant comme des « statuts » de sièges. Restant sur ce thème, il conçoit ensuite d’étonnants fauteuils hétéromorphes, faits de prodigieux enroulements de fils, ficelles et lacets multicolores. En 1988, il réalise un trône fait de trompettes, qui est offert à Miles Davis lors d’un festival du jazz; suit, un siège constitué à l’aide de milliers de CD. Entre-temps, Max Cartier a racheté une grande péniche en Camargue, pour en faire un logement-atelier qu’il va amener à Paris, en suivant le Rhône. Sa péniche, baptisée « Bessie Smith » fait sensation, lorsqu’il vient l’amarrer sur la Seine, au droit de l’Institut de France où siège désormais son ami Jacques Couelle. Max doit même à l’architecte d’être relié au réseau téléphonique, grâce à la ligne tendue à travers les arbres du quai, que l’académicien a branché dans son bureau.
Un jour, le projet de construction de la « passerelle des Arts » vient déranger cet équilibre précaire fondé sur le copinage. « Bessie Smith » devrait aller s’amarrer ailleurs, mais à un tarif déraisonnablement alourdi. Trop cher pour Max, « marinier » sans affrètement: il met sac à terre et « rentre » à Nice. Ses « affaires » ont tourné sans lui: elles continueront; d’autant plus que le climat des nuits de la Côte s’est alourdi lui aussi: Max n’y retrouve pas la légèreté sympathique qui en faisait le charme: à l’avenir, il ne sera plus que plasticien. L’envie ne manque pas, ni les idées. Sur la fin des années 80, dans un contexte international marqué par de nombreux conflits d’ordre racial, la L.I.C.R.A. demande à plusieurs artistes de la région d’imaginer une œuvre symbolisant le refus de l’inimitié entre les peuples. La ligue souhaite toutefois que les références religieuses en soient bannies. Max Cartier relève la gageure, à sa manière: il imagine de réunir en un même monument -ô combien symbolique! -les signes majeurs des trois plus grandes religions monothéistes. Son « Trois en un » amalgame donc la Croix chrétienne, le croissant de l’Islam et le Bouclier de David des Juifs dans une ensemble très fort qui semble signifier à tous que des confessions issues d’un tronc commun n’auraient jamais dû être séparées au détriment de leurs fidèles respectifs, tous enfants d’Abraham et du Livre.
Changeant complètement de sujet, Cartier s’est ensuite intéressé aux… poêles des chefs de cuisine. Ayant obtenu des « toques » les plus étoilées (Ducasse, Loiseau, Bocuse, Maximin, Vergé, etc.) qu’elles lui confient leurs ustensiles de prédilection, il les a réinventés en fonction de leur taille et de leur forme, selon un parti plaisamment anthropomorphique, où chaque poêle devient un personnage qu’on dirait dérivé, selon le cas, de Miro, de Calder ou de Giacometti. Puis sont venus, assez naturellement, comme découlant de la somme des œuvres antérieures, les « Hommes de pierres » des années 90.
Pour Max, le temps d’une large reconnaissance en tant qu’artiste. C’est un de ses géants de pierres, plaisamment baptisé « Le Voyageur » que la Chambre de Commerce de Nice a choisi et commandé, pour l’installer au sortir de l’aérogare, à l’occasion du cinquantième anniversaire de son ouverture. Un colosse de plus de 7 mètres de haut et de 35 tonnes: un voyageur à jamais immobile sur fond de palmiers, de mer et de ciels bleus, pour accueillir les globe-trotters descendus aux bords de la Baie des Anges.
« Le Voyageur », au fait, c’est également le pseudonyme que pourrait revendiquer Max Cartier. Peut-être n’a-t-il pas parcouru inlassablement l’immensité des espaces infinis: mais les espaces intérieurs – ceux qui conduisent de soi -même à soi -même, en passant par tous les points de vues de la création -n’ont plus guère de secret pour lui. Au passage, il a retenu l’immense leçon de Degas: il a beau s’attaquer à des travaux qu’on dirait renouvelés d’Hercule: Il a toujours eu le souci d’ « effacer par le travail, la trace même du travail »…
René CENNI